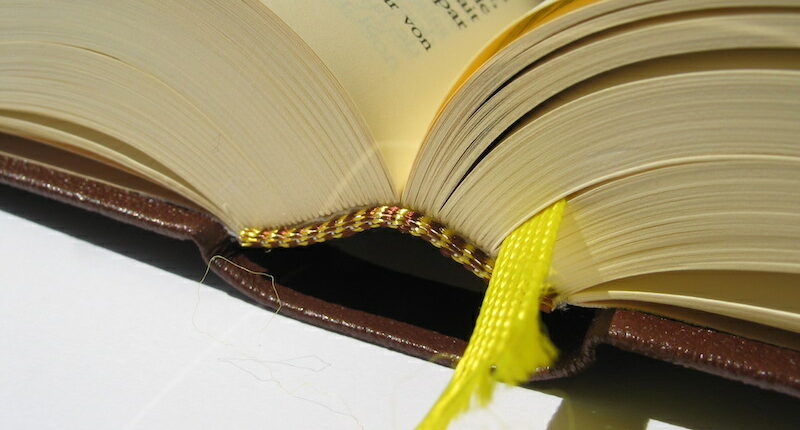
Ajouter de la Vie à nos années
Hiver 2024. Un cri éclate sur les ondes : « Mes amis, au secours : une femme vient de mourir abandonnée, cette nuit à trois heures, dans le couloir des urgences de l’hôpital, dans l’attente d’une prise en charge qui ne viendra jamais ». Vous aurez sans doute reconnu ici un autre cri poussé par l’abbé Pierre, il y a 70 ans. On espérait alors que les pouvoirs publics allaient tout faire pour que cesse le scandale des sans-abris… On sait qu’il n’en est rien aujourd’hui. Pire : le scandale continue et s’étend à l’ensemble des métiers du soin et donc, potentiellement, à l’ensemble de la population ; et on ne cesse de déplorer le manque de soignants dans les hôpitaux, de médecins dans nos campagnes, d’accompagnants auprès des enfants ou des adultes handicapés…
C’est dans ce contexte que revient la question de « l’aide à mourir » pour laquelle, à en croire les sondages, une majorité de français se déclare favorable. Une loi cherche à se frayer un chemin sur le suicide assisté, l’euthanasie (il faut appeler un chat un chat). Rien n’est fait, mais tout se dit, le meilleur et le pire. Mais on peut s’interroger sur les motivations profondes de ceux qui, sous prétexte de compassion envers les souffrants, voudraient demander une fois de plus à des spécialistes du geste de soin (médecins ou infirmières) d’être des professionnels du geste qui tue.
La question n’est simple pour personne, mais elle est trop l’écho de personnes en bonne santé et que la perspective de leur propre mort obsède. Ceux qui ont veillé un malade durant des semaines, particulièrement lorsque son « pronostic vital » est engagé,
savent combien il est difficile de se mettre à leur place. La douleur du malade est une chose ; sa souffrance en est une autre. J’ai le souvenir personnel d’avoir accompagné mon père qui s’approchait de la fin de sa vie et qui sentait son corps se défaire peu à peu. Fréquemment, la douleur venait crisper les traits de son visage pendant quelques instants, puis il reprenait son sourire courageux. Certains auraient suggéré « qu’on fasse quelque chose pour qu’il ne souffre plus ». Lui, ce n’est pas ce qu’il demandait. Il attendait notre main compatissante, il attendait la main de Dieu. Et, pour avoir été présent à son dernier souffle, j’ai cette certitude que cette main de Dieu l’a aussitôt tiré sur son cœur.
On ne résoudra jamais la question de la souffrance en cherchant à l’éradiquer, car alors ce ne sera plus seulement ceux qui meurent mais aussi — pourquoi pas ? — les dépressifs, les handicapés qu’il faudra euthanasier « pour leur bien », les prisonniers dont la vie carcérale n’a plus de sens. Jésus n’a jamais légitimé la souffrance (on ne peut ignorer qu’il ait guéri beaucoup de personnes) mais il ne l’a pas non plus supprimée. Plus encore : il a assumé cette souffrance jusqu’à l’épreuve ultime de la croix et du sang. Quel monde voulons-nous construire : un monde qui nous aide à mourir ou un monde qui nous aide à vivre ? Un ami prêtre malade, de retour d’un rendez-vous avec son chirurgien, m’avait raconté que celui-ci lui avait proposé une opération de la dernière chance. Il lui avait répondu par la négative, en lui disant : « je préfère ajouter de la vie à mes années que des années à ma vie ». Ajouter de la Vie à nos années : voilà un bon sujet pour un choix de société, non ?
Père Rémy CROCHU

